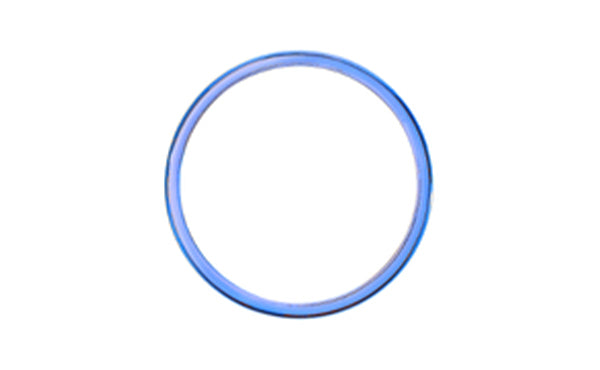 Bague en or bleu
Bague en or bleu
Jusqu'à présent, l'or bleu n'a pas réussi à s'imposer sur le marché de la bijouterie car il n'a pas encore été possible de produire un alliage d'or avec une belle couleur bleue uniforme qui convienne également à la transformation en bijoux. Cependant, de nombreuses tentatives et expériences ont déjà été menées pour rendre l’or bleu adapté à la joaillerie. Il existe déjà plusieurs demandes de brevet pour les alliages d’or bleu.
L'or bleu et son histoire
La plus ancienne source mentionnant l'or bleu provient du lexique français Plomteux de 1788.
Une composition précise d'un alliage d'or bleu a été donnée dans un ouvrage de référence de 1855 par les auteurs C.-D. Gardissal et F. Tolhausen ont noté. La recette est la suivante : 75 % d’or fin et 25 % de fer donnent de l’or bleu.
Dans les années 1960, la couleur de l'or bleu n'était généralement produite que superficiellement. L’inconvénient de cette méthode est que la couleur ainsi créée s’estompe avec le temps et que le bijou prend un aspect tacheté.
Des alliages solides d’or bleu peuvent, par exemple, être produits en combinant de l’or pur et de l’indium ou de l’or pur et du gallium. Cependant, les deux méthodes présentent l’inconvénient que leurs nuances de bleu ne sont ni particulièrement belles ni particulièrement faciles à travailler.
En 1985 et 1995, Vittorio Antoniazzi, émigré en Argentine, a breveté des alliages d'or bleu qu'il avait développés. L’un d’eux est composé d’or fin, de nickel, de chrome, de molybdène, de vanadium, de carbone, de tungstène et de fer. La couleur bleutée de l'alliage est intensifiée par un fort chauffage.
En 1991, le joaillier genevois Ludwig Muller dépose un brevet pour un autre procédé. Ici aussi, les alliages de départ – cette fois composés d’or, de fer et de nickel – sont colorés en or bleu par des températures très élevées. Depuis lors, l'inventeur lui-même fabrique des bijoux à partir de ce matériau.
Il existe également des pièces de monnaie fabriquées dans cet or bleu, qui ont été produites par la Monnaie de Paris pour commémorer le 50e anniversaire du drapeau européen.
Alliages dans le lexique
Exploitation aurifère
